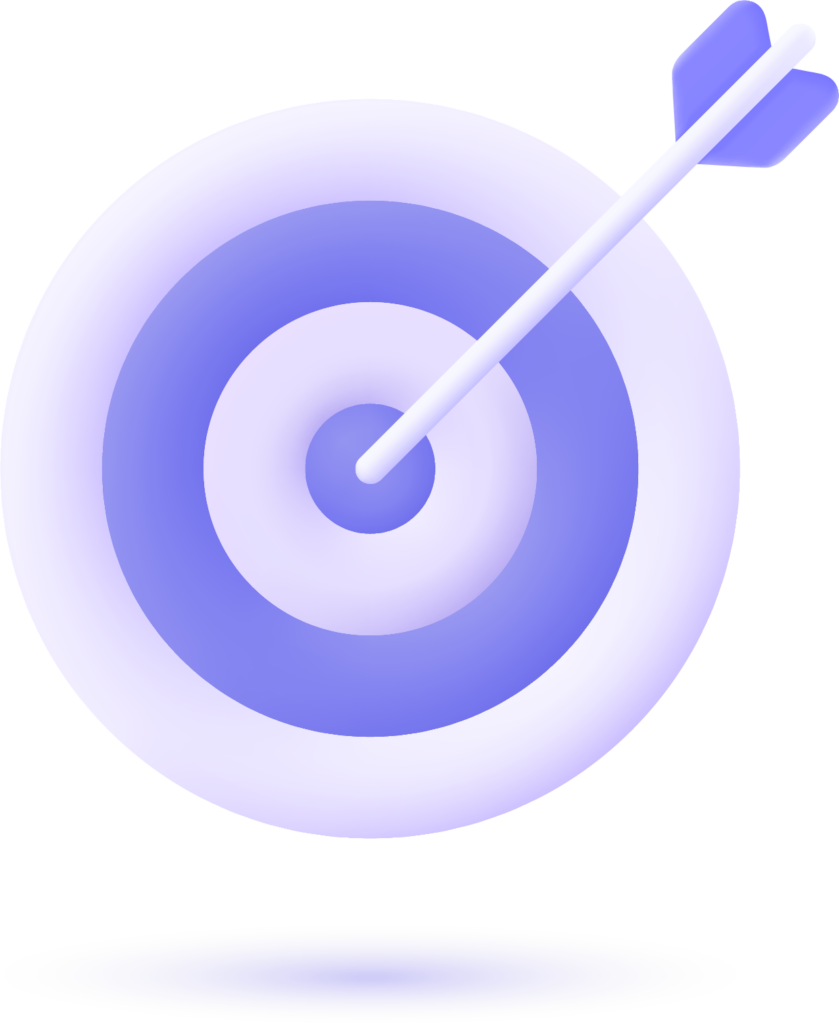IAS 38 – Immobilisations incorporelles
La valeur d’une entreprise ne se lit pas uniquement dans ses usines, ses bureaux ou son matériel. Dans certains secteurs, notamment le jeu vidéo, la tech ou la pharma, l’essentiel de la richesse se cache derrière des actifs incorporels. Plateformes, moteurs graphiques, jeux, logiciels, algorithmes : tous sont au cœur de la création de valeur.
Problème : comment traduire cette valeur en langage comptable ? La norme IAS 38 encadre strictement la reconnaissance et la capitalisation des actifs incorporels générés en interne.
Pourquoi c’est un sujet sensible
Contrairement à une machine ou un immeuble, un actif incorporel n’a pas de substance physique. Évaluer son potentiel futur ou chiffrer son coût exact peut vite devenir un exercice subjectif. La difficulté est double :
- déterminer si l’actif générera effectivement des avantages économiques futurs ;
- mesurer de manière fiable le coût de développement.
Recherche vs développement : la frontière essentielle
IAS 38 impose une distinction nette entre recherche et développement :
- Recherche : acquisition de nouvelles connaissances, exploration d’applications potentielles, conception de prototypes théoriques… Tous ces coûts sont passés en charges immédiatement.
- Développement : application des résultats de la recherche à un plan concret visant à créer un produit ou un service nouveau ou amélioré. Ces coûts peuvent, sous conditions, être capitalisés.
👉 Exemple : l’exploration d’un nouveau moteur de jeu est de la recherche (charges). La construction d’un prototype jouable basé sur ce moteur est du développement (potentiellement capitalisable).
Les critères pour capitaliser
Un projet interne peut donner lieu à la reconnaissance d’un actif incorporel uniquement si l’entreprise démontre :
- la faisabilité technique du projet ;
- son intention d’achever l’actif pour l’utiliser ou le vendre ;
- sa capacité à l’utiliser ou à le vendre ;
- l’existence probable d’avantages économiques futurs (marché identifié ou utilité interne démontrée) ;
- la disponibilité des ressources nécessaires (techniques, financières, humaines) ;
- sa capacité à mesurer de manière fiable les dépenses attribuables.
Sans ces preuves, les coûts restent en charges.
Que peut-on capitaliser ?
Le coût d’un actif incorporel généré en interne inclut :
- les dépenses directement liées à la création et au développement (ex. salaires des équipes techniques, tests de prototypes, licences nécessaires au développement) ;
- les coûts nécessaires à la préparation de l’actif pour son usage prévu.
Ne sont jamais capitalisés : frais commerciaux, coûts administratifs non directement imputables, pertes d’exploitation initiales, formation du personnel.
Après la mise en service
Même après le lancement, certaines dépenses peuvent encore relever du développement (par exemple, renforcer la capacité d’une plateforme pour supporter davantage d’utilisateurs). Mais attention : la majorité des coûts ultérieurs sont considérés comme de la maintenance et restent en charges.
En pratique : vigilance et rigueur
La capitalisation des actifs incorporels générés en interne est une arme à double tranchant. Bien maîtrisée, elle reflète fidèlement les investissements réels de l’entreprise et valorise son bilan. Mal appliquée, elle peut gonfler artificiellement les comptes et poser des problèmes de fiabilité.
La clé : mettre en place des systèmes de suivi robustes (gestion du temps, calcul des coûts, documentation projet) et challenger régulièrement la pertinence de la capitalisation avec un œil externe.
Conclusion
Les actifs incorporels sont aujourd’hui au cœur de la compétitivité des entreprises, particulièrement dans les secteurs innovants. Mais leur traitement comptable reste délicat, entre subjectivité, exigence normative et enjeux financiers.
Chez TREVYS, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de processus fiables pour distinguer ce qui relève de la recherche (charge) de ce qui peut être capitalisé (développement), sécuriser les critères de reconnaissance et fiabiliser la valorisation des projets stratégiques.